The Knick
- Albert Caporossi
- 10 juin
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 juin
La série The Knick se déroule en 1900 au Knickerbocker Hospital de New York (en abrégé “The Knick”), un établissement fictif inspiré d’un hôpital réel de l’époque. Dès le titre, la série signale son ancrage historique : le nom “The Knick” vient bien du Knickerbocker Hospital (institut fondé en 1862 puis rebaptisé en 1913). Le contexte est celui d’une médecine naissante et expérimentale : Clive Owen (Dr Thackery) incarne un chirurgien avant-gardiste à l’amphithéâtre (voir visuel), conscient que la science progresse à pas de géant.

Époque et contexte historique influencent beaucoup la représentation de l’addiction : à cette époque le concept de réhabilitation n’existait pas encore, la cocaïne et l’opium étaient légaux et considérés comme des « merveilles » médicales. Le comportement des médecins de l’époque (on les voit s’auto-expérimenter) reflète cette ignorance des dangers.
Beaucoup d’éléments historiques sont authentiques : les chirurgies représentées sont documentées et reproduites à l’identique (même les manuels et photos de l’époque ont servi de référence), et la clinique fictive s’inspire du contexte social de Harlem (charité pour « pauvres méritants »).
En revanche, l’intrigue principale est fictive. Les principaux personnages du Knick ne sont pas des personnages historiques réels, mais certains sont inspirés de figures réelles.
En partie. Dr. Thackery lui-même est calqué sur le Dr William Stewart Halsted (pionnier de la chirurgie à Johns Hopkins), connu pour sa dépendance à la cocaïne et à la morphine.
Le Dr Edwards ressemble à des chirurgiens afro-américains de l’époque (Daniel Hale Williams, Louis T. Wright). Les créateurs ont ainsi glané de l’histoire pour donner du réalisme à leur fiction.
Formes d’addictions dans The Knick
Dans The Knick, les addictions aux substances sont omniprésentes, en particulier la cocaïne et l’opium (et par extension l’héroïne/laudanum comme traitement) consommés par les médecins. Le Dr Thackery s’injecte régulièrement de la cocaïne en pleine journée et fréquente un fumoir d’opium le soir. Au début de la saison 2, on le soigne en cure de désintoxication en lui administrant de l’héroïne pour atténuer son craving. D’autres formes apparaissent : par exemple, la jeune infirmière Lucy va jusque-là à se prostituer pour obtenir de l’opium.

Addictions comportementales modernes (jeux vidéo, réseaux sociaux, binge-watching) n’ont pas lieu d’être dans un récit de 1900, mais on peut noter que les médias actuels traitent de ces addictions. Des études montrent que le binge-watching ou les jeux compulsifs mobilisent des mécanismes proches des drogues (impatience, quête de dopamine) et entraînent des conséquences sociales similaires. Par exemple, comme pour les addictions aux substances, les utilisateurs pathologiques de télévision ou de jeux perdent souvent le contrôle, négligent leur santé ou leur travail. Ainsi, bien que la série ignore ce volet, on observe de nos jours que cinéma et séries établissent des parallèles entre dépendances comportementales et physiques (impulsivité, isolement, tolérance).
Stéréotypes et idées reçues
The Knick met en scène les représentations sociales de l’addiction caractéristiques de son époque. Les stéréotypes y sont explicites : le conseil d’administration de l’hôpital considère l’addiction comme un choix moral et s’en sert pour stigmatiser les malades (« Addiction is a problem of lowly, moral degenerates », déclare l’un des membres).
Les alcooliques et fous n’étaient d’ailleurs pas admis dans le vrai Knickerbocker Hospital de 1914. Cette vision de l’addiction comme « faiblesse morale » est régulièrement exposée à l’écran.
En face, la série donne voix aux pionniers qui pensent l’addiction comme une maladie : Thackery réclame un service spécial (« Inebriety Ward ») et un laboratoire de recherche, et parle des centres de plaisir dans le cerveau. La scène dans l’asile où il tente de persuader le conseil médical (qui croit qu’« on naît déviant ») souligne ce conflit moral/scientifique.
Au final, The Knick ne se contente pas de reproduire les clichés : il les expose pour mieux les critiquer. En montrant un chirurgien brillant mais addict, la série déjoue l’idée reçue selon laquelle les malades ne seraient pas intellectuels ou valides. Elle humanise aussi les victimes (ex. la patiente en cure qui s’entretient avec Abby). En ce sens, elle tend à déstigmatiser l’addiction en la présentant comme un problème médical complexe et non plus comme un péché : comme le note le Television Academy, “Addiction is disease” est une notion affirmée face au point de vue moralisateur. Cependant, la représentation reste ambivalente – l’issue tragique de certains personnages (Abby, Thackery) rappelle que l’addiction est dévastatrice.

Caractéristiques des personnages addicts
Le cas typique est celui du Dr John Thackery (Clive Owen). C’est un homme de caractère complexe et contradictoire : son génie et son ambition en font un chirurgien exceptionnel, mais son addiction le rend imprévisible, obsessionnel et marginal. Comme le dit Clive Owen, « Thackery est brillant et choquant en même temps ». Son addiction est centrale à son personnage et fait avancer l’intrigue : de l’épisode pilote à la fin, son état dépende de son besoin de drogue (il exécute des opérations en état de manque, s’isole de Lucy, puis termine la série en pleine rechute). Cette addiction influence toutes ses relations : elle brise sa liaison avec l’infirmière Lucy (qui obtient autre chose que de l’amour en échange de stupéfiants), l’éloigne de sa collègue Abby Cornelia (au point qu’elle finira elle-même par succomber), et même de ses mentors. Thackery devient de plus en plus isolé dans sa quête d’expérimentation.

Les autres personnages sont aussi marqués, quoique secondairement :
Lucy Elkins est abandonnée et fragilisée par la dépendance de Thackery.
Herman Barrow, l’administrateur, accumule des dettes de jeu (une addiction comportementale implicite) qui le plongent dans l’illégalité.
Mais ce sont surtout les comportements addicts contemporains (jeux, écrans) qui restent quasi absents de l’époque.
Sur les liens personnels du réalisateur/amateur à l’addiction : il n’existe pas d’indication que Steven Soderbergh ou les scénaristes aient projeté leurs propres expériences de drogue dans la série. Ils se sont plutôt inspirés d’histoires réelles.

Thackery est explicitement inspiré du chirurgien William Stewart Halsted, dont la biographie a servi de base. Clive Owen a même lu son autobiographie pour parfaire le rôle. L’équipe a donc puisé dans l’histoire médicale plutôt que dans une psyché propre.
Traitement artistique de l’addiction
Sur le plan visuel et sonore, The Knick utilise divers procédés pour évoquer l’addiction :
L’image : la mise en scène par Soderbergh est souvent statique et clinique (longs plans fixes dans la salle d’opération, gros plans chirurgicaux).
Lors de la scène récurrente du fumoir d’opium, on note l’usage de filtres rougeâtres sur l’éclairage – créant un effet « enveloppant » mais déshumanisant. Cette teinte évoque la nausée ou l’enfermement sensitif, soulignant la transe de Thackery.

De même, le rythme visuel est saccadé dans ses moments de manque (par exemple lors de sa cure en mer, où le montage alterne les plans du ciel et du pont pour rendre son délire).
La musique : le compositeur Cliff Martinez propose un mélange de sons électroniques ‘old-school’ (sons de synthé, percussions répétitives et souffles écho). Ce score envoûtant, presque « hypnotique », sous-tend l’état intérieur du protagoniste. Les motifs musicaux sont lancinants, renforçant l’angoisse des scènes de crise ou de resucrage.
Narration/littérature : la série n’emploie pas de voix off pour décrire l’addiction, elle privilégie le réalisme visuel. Les dialogues eux-mêmes traitent directement du sujet (réunions du conseil, confrontation avec Abby), sans métaphores ésotériques. L’aspect documentaire est renforcé par le recours à des archives réelles pour les interventions médicales.

Réception critique et impact
Les critiques ont globalement salué The Knick pour son réalisme cru et sa profondeur thématique. La représentation de l’addiction a été vue comme audacieuse et moderne.
Par exemple, Vice souligne que le show démystifie l’addiction en la présentant sous ses deux faces : la compassion médicale et le refus moral. La série est qualifiée de « non édulcorée », loin des clichés, et comparable aux débats actuels sur la dépendance.
Le New York Times et d’autres journaux ont noté la fidélité historique : toutes les opérations effectuées sont basées sur des cas réels.
Concernant la stigmatisation, The Knick semble plutôt encourager l’empathie. Les personnages addicts sont montrés comme dignes de soin (Thackery comme un patient médecin). En contraste, la série met en lumière la persistance de la stigmatisation de l’époque (voir la phrase du conseil). Ainsi, le propos est nuancé : il suggère que l’addiction est un problème à la fois individuel (la tragédie personnelle de Thackery, Abby, Lucy) et collectif (nécessité d’une structure hospitalière pour les traitements). Le film The Knick participe au dialogue sur la dépendance, montrant comment une société en mutation tente d’envisager l’addiction comme un enjeu médical plutôt que moral.
Addictions comportementales modernes
Bien que The Knick soit centré sur des substances, l’évolution récente du récit sur l’addiction dans les médias inclut désormais des dépendances comportementales. De nombreuses séries et films contemporains abordent aujourd’hui le binge-watching, l’addiction aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo. Ils insistent souvent sur les similitudes : comme pour l’alcool ou la drogue, ces comportements compulsifs activent le « centre de récompense » du cerveau (dopamine, besoin de gratification) et entraînent une perte de contrôle et des conséquences sociales négatives. Les différences notables résident dans l’absence d’intoxication chimique et d’effets physiques immédiats (pas de « overdose » classique), mais les études montrent que neurobiologiquement et cliniquement, le profil (impulsivité, insomnie, isolement) est très comparable. En somme, les fictions actuelles soulignent que les addictions « modernes » et traditionnelles partagent bien des caractéristiques, tout en pointant leur singularité (pas de support pharmacologique, contexte numérique).
Représentations sociales de l’addiction
La série reflète également les représentations culturelles de son temps.
Par exemple, la cocaïne (symbole de modernité chirurgicale) est valorisée chez les élites médicales, tandis que les laissés-pour-compte de la société sont tenus à l’écart (les pauvres alcooliques sont exclus de l’hôpital).
The Knick met en parallèle ces attitudes : il critique implicitement l’acceptation culturelle du vice chez les « puissants » (comme Thackery) par rapport à celle des « déclassés » (les habitants du quartier noir ou ouvrier). De plus, l’œuvre s’interroge sur les normes du XXe siècle : le Dr Thackery parle de l’addiction en tant que maladie du cerveau, ce qui questionne l’idée reçue de l’addiction comme simple vice ou faiblesse. Par ses dialogues et son intrigue (notamment l’opposition entre points de vue moral et scientifique), la série invite le spectateur à réfléchir à ces représentations.
Extraits révélateurs de l’addiction
Les dialogues et situations montrent crûment l’emprise de la dépendance.
Par exemple, Clive Owen décrit son personnage : « The first image you see of me in this is injecting myself with liquid cocaine… at that time, cocaine was totally legal ».
Cette première scène nous saisit immédiatement sur la gravité de son addiction.

Plus loin, dans l’épisode 2, une prostituée lui demande « You coming back soon? » et Thackery répond sans espoir : « Where else would I go? » – phrase qui illustre la solitude et le cercle vicieux du dépendant.
Sources : Analyse des épisodes et interviews des créateurs, critiques médias, documentation historique sur l’hôpital Knickerbocker.
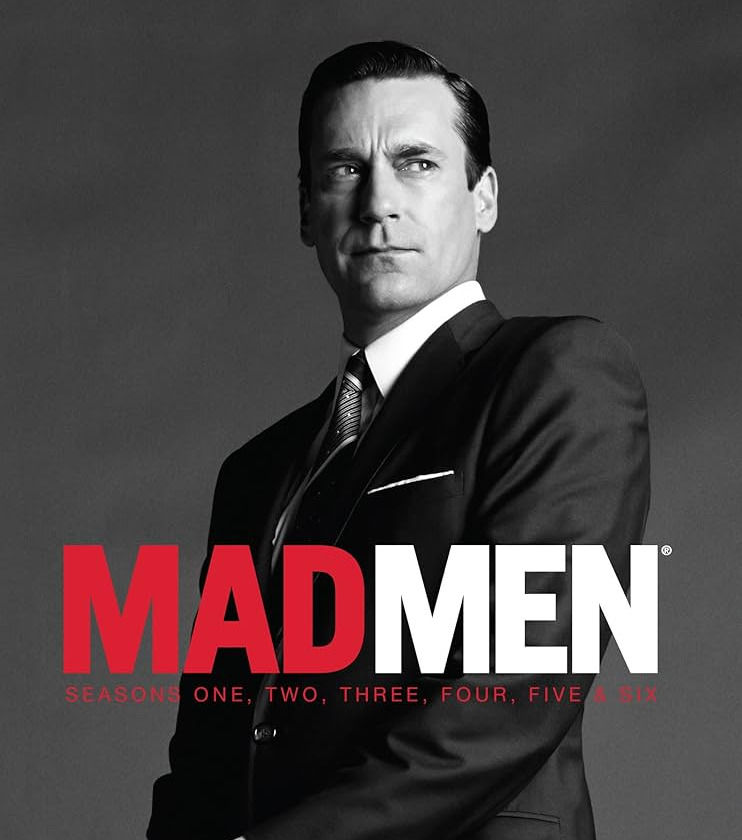

Bonjour malheureux webmaster 😘